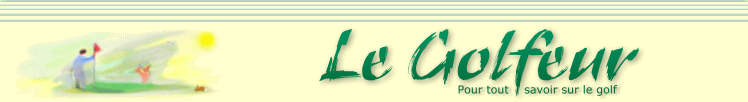ue vous soyez joueur, entraîneur, arbitre ou
parent, vous êtes constamment sous l’influence de plusieurs facteurs
psychologiques qui déterminent vos pensées et donc vos comportements. Autant
chez les sportifs, les artistes que les dirigeants de compagnies, ceux et
celles qui réussissent sont obsédés par leur rendement et les performances
qu’ils donnent à chaque jour. L’étude du comportement humain en contexte
sportif est complexe mais logique, c’est pourquoi la psychologie sportive
intrigue les gens depuis déjà plusieurs années.
ue vous soyez joueur, entraîneur, arbitre ou
parent, vous êtes constamment sous l’influence de plusieurs facteurs
psychologiques qui déterminent vos pensées et donc vos comportements. Autant
chez les sportifs, les artistes que les dirigeants de compagnies, ceux et
celles qui réussissent sont obsédés par leur rendement et les performances
qu’ils donnent à chaque jour. L’étude du comportement humain en contexte
sportif est complexe mais logique, c’est pourquoi la psychologie sportive
intrigue les gens depuis déjà plusieurs années.La psychologie sportive
est une science qui a pour but de décrire, d’expliquer et de prédire les
comportements humains dans des situations de sport et d’activité physique.
Le sport est quant à lui un terme plus difficile à définir. En fait, le
sport n’a pas de définition universellement acceptée. Les termes de jeu,
partie, activité et récréation que constitue sa définition sont difficiles à
conceptualiser. Une chose est tout de même certaine, la fascination
collective pour le sport et l’activité physique atteint des proportions
jusqu’ici inégalées partout à travers le monde.
La première expérience documentée
en psychologie du sport
date de plus de 100 ans.
La psychologie sportive (PS) est souvent décrite comme une jeune
spécialisation de la psychologie. En fait, la PS provient d’une savante
association des sciences de l’activité physique, de la pédagogie, du
contrôle moteur et de la psychologie. La première publication de cette
nature est associée à Norman Triplett en 1897-1898, intéressé à déterminer
si l’influence d’une audience était positive ou négative sur la performance.
Les recherches du début de vingtième siècle visent alors à comprendre les
conditions de pratique qui mènent à l’apprentissage. Plusieurs pays ont
significativement contribué à rapidement combler le manque de fondation
scientifique en PS, particulièrement la Russie, l’Allemagne et le Japon. Aux
États-Unis, Coleman Griffith est reconnu comme le père de la PS en Amérique
avec la publication de deux ouvrages : «Psychology of Coaching» en
1926 et «Psychology and Athletics» en 1928. Il est à noter que les
barrières de langue et les mauvaises relations entre les différents pays ont
considérablement ralenti la progression de cette science.
Entre les deux guerres mondiales, la psychologie s’est inscrite dans les
programmes militaires. Plusieurs recherches avaient pour but de déterminer
les facteurs qui jouent un rôle dans la performance aux tâches requises lors
d’opérations militaires, par exemple, la diminution du niveau de
concentration en état de fatigue ou l’effet du stress sur la précision du
tir.
La dimension scientifique de la PS prend réellement son essor en 1965
avec le premier regroupement professionnel : l’ «International Society of
Sport Psychology». Suit en 1970 la parution du premier périodique
entièrement consacré à la PS : l’ «International journal of sport
psychology». Aux États-Unis, c’est en 1985 qu’a été formé l’«Association
for Advancement of Applied Sport Psychology». Depuis ce temps,
l’application de la méthode scientifique en recherche a contribué à faire de
la PS une science reconnue et soutenue par de solides théories et modèles
conceptuels.
Rappelons qu’au début des années 70, un fort courant de promotion de la
santé s’est établi dans les mentalités. Les gens étaient fortement
encouragés à devenir plus minces, à mieux manger, et à adopter un style de
vie plus sain. Les psychologues sportifs, qui s’intéressaient alors à la
santé via la forme physique et l’exercice, ont joué un rôle actif dans la
promotion des recherches impliquant les programmes d’activités physiques.
Plusieurs domaines de la science du sport sont en étroite relation avec
la pratique professionnelle en PS. En voici quelques exemples :
l’apprentissage de la technique (biomécanique et pédagogie), l’enfance
(développement moteur, médecine sportive) l’amélioration des entraînements
(périodisation, contrôle moteur et physiologie), la vie sociale qui entoure
l’athlète (sociologie et psychologie).
Chez les athlètes qui recherchent la performance de haut niveau,
l’intervention concerne aussi les principales orientations de motivation, la
confiance en soi, l’organisation systématique du calendrier de compétition,
la gestion de l’anxiété de compétition et la planification stratégique
d’objectifs de rendement à l’entraînement. D’autres habiletés mentales font
l’objet d’exercices précis soit : l’imagerie mentale, l’utilisation de mots
clés (neurolinguistique), le souci du langage non verbal (dos droit, tête
haute), le contrôle des pensées, l’optimisme, etc. En terminant, le
développement moral et éthique, la réhabilitation après blessure et l’après
carrière des athlètes de haut niveau sont également étudiés en PS.
Aujourd'hui, la psychologie prend un essor inestimable. Tous les
intervenants du sport sont conscients de l’importance des habiletés mentales
dans la pratique d’un sport ou d’une activité physique. Les athlètes
eux-mêmes prennent de plus en plus souvent les devants en se demandant
comment la psychologie sportive peut les aider à atteindre leur limite. Ces
athlètes savent que ce plein potentiel leur est simplement bloqué par des
variables psychologiques qui les empêchent d’exploiter leurs qualités
athlétiques et techniques supérieures.
Vivre les avantages de la psychologie sportive demande toutefois des
efforts qui pourtant sont à la portée des débutants et amateurs. C’est
souvent ces derniers qui en retirent le plus d’avantages, les professionnels
appliquant déjà de façon innée les concepts que cette «nouvelle» science
nous suggère.
Depuis déjà quelques années, les interventions individuelles (counselling)
se font de plus en plus populaires, autant avec une clientèle sportive élite
qu’avec les amateurs passionnés. Les bénéfices tirés de l’utilisation des
techniques psychologiques ne se limitant pas qu’au sport, plusieurs chefs
d’entreprise nous consultent en psychologie sportive et constatent une nette
amélioration de leur rendement. Il est facile de comparer le travail et les
efforts que nécessitent les performances d’un gestionnaire de multinationale
et les performances sportives. À ce niveau, l’aide passe souvent par une
meilleure analyse du stress subie quotidiennement qui, comme on le sait, est
désormais standard dans notre société contemporaine.
David Guertin
SQM01-T-52
Phase 1 : 1897-1950
-Intervention individuelle ponctuelles
-Recherche sur :


 Apprentissage
moteur
Apprentissage
moteur


 Personnalité,
motivation et performance
Personnalité,
motivation et performance


 Facilitation
sociale
Facilitation
sociale
États-Unis :
Coleman Griffith, scientifique œuvrant sur les perceptions et les gestes
moteurs, études sur la personnalité : élaborations de théories sur les
facteurs psychologiques influençant la performance motrice. Théorie de la
personnalité.
Allemagne :
Premier laboratoire de psychologie du sport, on y étudie les comportement,
l’apprentissage et le développement.
Russie :
Premier département dédié uniquement à la psychologie du sport
inauguré à Moscou en 1920, On y travail sur les habiletés psychologiques
de performance, l’influence de différents degrés d’exercice physique sur
les fonctions motrices et les traits physiologiques reliés à la
performance.
Japon :
Institut de recherche en éducation physique dans la collectivité.
Débats sur l’attitude et les opinions face à l’activité physique
culturelle. La place du sport d’élite et du sport de masse comme «facilitateur»
social.
Phase 2 : 1960-1965


 -Orientation
clinique et analytique rejetée
-Orientation
clinique et analytique rejetée


 -Orientation
«behaviorale» critiquée
-Orientation
«behaviorale» critiquée


 -Bases
des théories de la motivation
-Bases
des théories de la motivation
Phase 3 : 1965-1975


 -Entrée
en Amérique de la philosophie orientale
-Entrée
en Amérique de la philosophie orientale


 -Regroupement
et associations facilitant les échanges
-Regroupement
et associations facilitant les échanges


 -Liens
établis entre la performance et l’activation mentale
-Liens
établis entre la performance et l’activation mentale